 |
|
| Plusieurs fiches thématiques vous proposent de partir à la découverte des départements français : physionomie générale, climat, curiosités naturelles, histoire, anciennes industries, personnages célèbres. |
|
|
A l'avènement de Hugues Capet au trône de France, les comtes de Poitiers et de Toulouse, rêvant les grandes destinées de ce dernier, se déclarèrent indépendants et entraînèrent à leur suite les principaux seigneurs de la Corrèze, qui méconnurent l'autorité royale jusqu'au moment du mariage de Louis VII le Jeune avec Éléonore de Guyenne, en 1137. En 1152, le concile de Beaugency ayant prononcé le divorce des deux époux, Eléonore, devenue libre, épousa quelque temps après Henri Plantagenet, qui, en 1155, devint roi d'Angleterre. La Corrèze passa alors au pouvoir des Anglais. En 1202, les barons du Poitou et d'Aquitaine s'étant soulevés contre Jean sans Terre, appelèrent à leur secours Philippe Auguste, qui le chassa d'Aquitaine. La Corrèze appartint à la France jusqu'au 12 mars 1259, époque à laquelle Louis IX, par scrupule de conscience, conclut avec Henri III d'Angleterre un traité par lequel il restituait à ce prince le Quercy, le Limousin, l'Agénois et une partie de la Saintonge. Mais en 1294, les Anglais furent presque entièrement chassés de la Guyenne, et la Corrèze redevint française. |
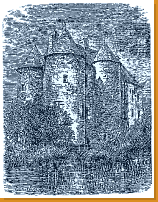
|
Pendant la guerre de Cent ans, la Corrèze affirma hautement son attachement à la France ; elle eut à supporter le poids de cette terrible guerre qui ruina notre pays, mais d'où la nationalité française surgit triomphante. En 1335, Philippe le Bel visita Brive, qu'il fit fortifier ainsi que plusieurs autres villes du Midi. Le 26 août 1346, la France éprouvait le désastre de Crécy, dont l'influence devait se faire sentir dans le Midi. En effet, le 1er novembre de la même année, les Anglais s'emparaient de Tulle, d'où le due d'Armagnac les expulsait quelques jours après.
La défaite de Poitiers (19 septembre 1356), suivie du fatal traité de Brétigny (18 mai 1360), fit retomber la Corrèze sous la domination anglaise. Sous Charles V, du Guesclin assiégea les Anglais dans Ussel et les chassa de la vicomté de Ségur. A peine l'ennemi était-il installé à Tulle qu'il en fut chassé par les habitants des campagnes voisines. Mais en 1374, Brive accueillit le due de Lancastre, frère du prince Noir, et résista aux sommations du duc d'Anjou, qui parut peu de temps après devant ses murs. Les Français attaquèrent la ville, la prirent et en décapitèrent les principaux magistrats, près de la porte Barbecane, qui avait donné passage aux Anglais et qui fut murée.
Plus tard, les Brivistes firent oublier leur moment de fablesse en chassant les garnisons anglaises des châteaux qu'elles occupaient dans le bas Limousin. La guerre d'embuscade, employée contre les Anglais, seconda les armes françaises. Le prince Noir, usé par les fatigues, mourut en 1376, et son père, Édouard III, le suivit un an après dans la tombe. Charles V mourait Iui-même en 1380, après de nouveaux succès remportés sur ses ennemis.
L'élan national ne se ralentit pas, et, malgré les calamités du règne de Charles VI, les Anglais n'obtinrent dans la Corrèze aucun succès important ; sous le règne de Charles VII, ils durent se retirer devant le roi triomphant et ses braves capitaines, parmi lesquels se distingua Dunois. Charles VII vint visiter le Limousin eu 1441, et passa à Tulle les fêtes de Pâques de cette année.
La Ligue du Bien public, cette dernière lutte de la féodalité impuissante contre le pouvoir royal, ne trouva pas d'écho dans le Limousin (1465). Deux ans auparavant, Louis XI avait visité cette province et séjourné à Brive, à Donzenac et à Uzerche, acclamé par la population ; il avait en même temps institué des cours de justice à Brive et à Uzerche. Sous Charles Vlll, Louis XII et François ler, un calme profond régna dans la Corrèze. Mais, sous Henri II, le protestantisme s'y étant répandu, y fit plusieurs adeptes, parmi lesquels Henri de la Tour, vicomte de Turenne, dont l'influence était grande dans le pays ; Argentat, Beaulieu et Uzerche suivirent sa cause. D'illustres capitaines, Biron, Coligny et Henri de Navarre, qui devait être plus tard Henri IV, répondirent à l'appel d'Henri de la Tour, devenu lui-même, en 1591, due de Bouillon.
Les protestants, sous la conduite des princes de Condé et de Coligny, ayant été défaits, le 13 mars 1569, à la sanglante bataille de Jarnac, dans l'Angoumois, par le duc d'Anjou, qui fut plus tard Henri III, les vaincus se retirèrent dans le Limousin. Ils occupèrent Lubersac, Juillac, Saint-Bonnet-la-Rivière ; Coligny s'empara de Beaulieu le 10 décembre 1569 et livra cette ville au pillage. Quelques années après, Tulle fut prise d'assaut par la Morie, maître de camp du vicomte de Turenne. |

|
A dater de cette époque commence une suite continuelle de surprises et d'escarmouches qui durèrent pendant tout le règne d'Henri III. Brive fut prise, le 24 juin 1577, par le duc de Biron ; un mois après, un autre chef protestant, Vivans, y commit d'abominables excès. Henri IV, en pacifiant la France, rendit la tranquillité à ces contrées ; héritier par son grand-père de la vicomté de Limoges, il la réunit à la Couronne. Sous Louis XIII, quelques seigneurs mécontents se révoltèrent en 1628 ; mais Richelieu, qui venait de prendre la Rochelle, leur prouva que le temps des rébellions était passé. Sous la Fronde, la femme du prince de Condé se réfugia à Turenne, en 1648, pour y organiser la guerre civile, mais ses partisans échouèrent au siège de Brive. Le peuple corrézien comprenait qu'il n'y avait rien à gagner dans ces agitations stériles et antipatriotiques suscitées par de mesquines ambitions.
Le 8 juin 1738, Charles-Godefroi, duc de Bouillon, vendit la vicomté de Turenne à Louis XV, pour la somme de 4 millions 200 000 francs. Depuis ce moment, la Corrèze a été associée au sort du reste de la France.
RETOUR première partie de l'Histoire de la CORRÈZE
|
|
:: HAUT DE PAGE :: ACCUEIL
|
|